« Le miroir de vingt ans de ma vie »
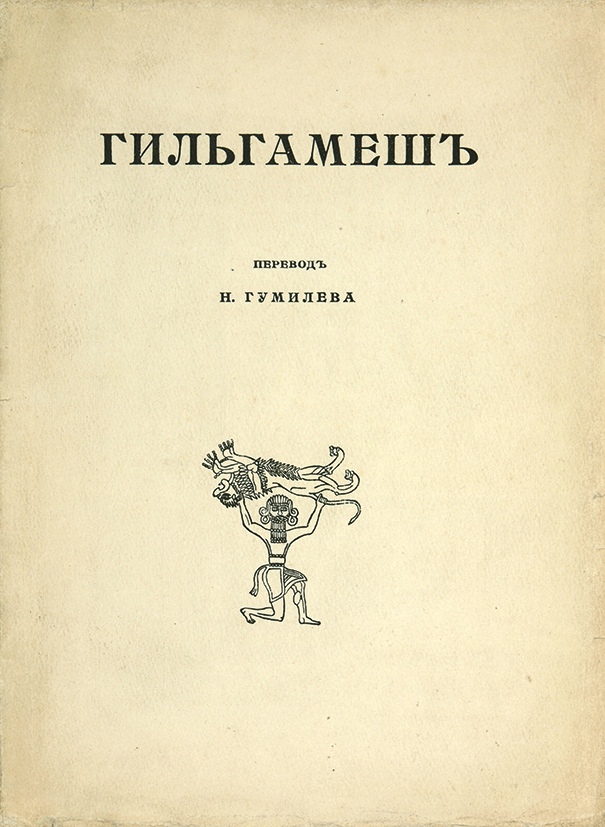
L’Appartement, André Markowicz, éditions Inculte
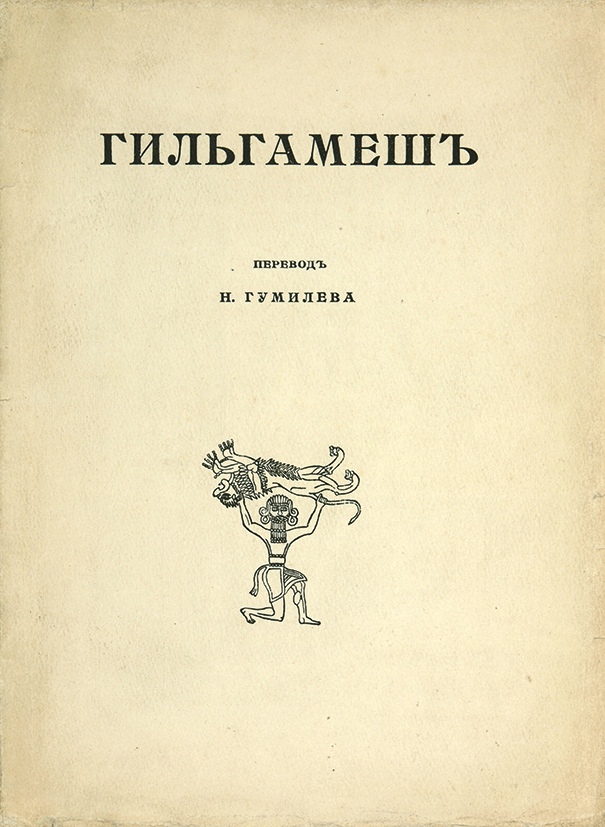
Pendant un plus d’un an, de l’été 2017 à l’automne 2017, je vous ai seriné des extraits d’un texte que j’étais en train d’écrire — et qui s’appelle « L’Appartement ». Ce texte, il est en vente demain, chez inculte, dans le même format que mes deux premiers volumes de « Partages » et que les « Ombres de Chine ». Je ne sais pas si c’est une suite, ou quelque chose de parallèle, ou quoi ou qu’est-ce — je sais une chose, c’est que, pendant toute cette période, et même plus tard, je n’ai quasiment vécu que, j’allais dire, dedans, dans ce texte qui m’est venu je ne sais pas comment, mais, à vrai dire, au début, par le mètre… le pentamètre iambique, qui, donc, n’existe pas en français, et qui est une des formes du décasyllabe. — Je commence ma chronique comme ça, et je sais que, ça y est, je suis mort. Comment voulez-vous comprendre ça, cette obsession que j’ai de ce mètre, à un moment où la métrique est considérée comme obligatoirement réactionnaire, et que personne ne sait ce que c’est, parce que ça n’existe (ou ça n’a existé) qu’en Angleterre, qu’en Allemagne et en Russie, c’est-à-dire, encore une fois, pas chez nous. Pas chez nous, pas seulement pas chez nous dans notre territoire, mais, surtout, dans notre imaginaire, dans notre mémoire passive, dans les connotations qui nous sont à la fois indispensables et inévitables pour nous situer quand nous lisons. — Et donc, oui, c’est venu de ce mètre. Et c’est venu de là, d’une conversation que j’entretiens, moi, avec ce mètre, et les textes, dans différentes langues, qui ont été écrits dans ce mètre, depuis le XVIe siècle. C’est venu de ça, parce que ça me place, d’office, dans une situation de déplacement — et je n’appelle pas « déplacement» une situation obligatoirement tragique. Non, c’est juste une situation qui prend tout mon livre en miroir.
*
Ce livre, comment en parlerais-je ? C’est un récit, oui, miroir, finalement, de vingt ans de ma vie, du début de mon travail de traducteur de théâtre, du début de ma traduction de Dostoïevski, jusqu’au moment présent. C’est le récit d’une entreprise, d’un essai pour faire se rejoindre, tant bien que mal, d’une façon ou d’une autre, les deux parts de ma vie, la langue russe, ma langue maternelle — au sens strict, la langue de ma mère —, et mon monde maternel, et la langue française, celle de mon père, avec ce déplacement supplémentaire, dans mon français — qui est ma langue de travail, la langue de ma vie quotidienne, la langue que j’aime, — du substrat juif ashkénaze, polonais.
Et puis, c’est le récit de la quête d’un lieu.
*
J’ai vécu mon enfance dans la banlieue de Paris (après l’âge de quatre ans), et nous revenions tous les étés dans une chambre d’un appartement communautaire de Léningrad, celle de ma grand-mère et de ma grand-tante, puis celle de ma grand-tante seule après le décès de sa sœur en 1974. Là, à travers les péripéties indicibles de l’histoire, rien n’avait bougé — du moins, c’est ce que je pensais. Chaque objet me semblait immémorial, tout était magnifique, immobile, animé. Là, ce n’est pas que je me sentais vivre, c’est que je savais que j’étais à ma place pour toujours, parce que c’était là qu’il y avait une durée qui me dépassait entièrement, et qu’il y avait une vie, une vie spirituelle, une vie d’amour et de regard. C’était une chambre, grande, encombrée de meubles, — tout ce qui avait pu être sauvé de la catastrophe, et alors même que, jadis, dans un temps que j’étais loin d’avoir connu — et que ma mère non plus n’avait jamais connu — c’est tout l’appartement qui était loué par mon arrière-grand-père, son épouse, et ses trois filles. L’immeuble, me disait ma grand-tante, elle l’avait vu se construire, ils s’y étaient installés en 1918, et n’avaient pas bougé depuis — si ce n’est pour être déportées en Sibérie, ou bien pendant la guerre. Et tous les livres que ma grand-tante aimait, ces recueils de poésie qu’elle achetait à parution, d’Anna Akhmatova ou d’Alexandre Blok, ou bien cette merveille, le Gilgamesh traduit par Nikolaï Goumiliov, tout était là. Et, à chaque fois que je venais, j’ouvrais ces livres, et je vivais.
Et puis, il s’est passé que le temps a passé — sans qu’on s’en rende compte, évidemment — et que l’immeuble a été déclaré en péril, et ma grand-tante a été relogée, en banlieue. Or elle avait 99 ans, et elle ne voyait quasiment plus. Mes parents l’ont donc fait venir en France, et c’est là qu’elle est morte. Et quand ma mère a rapporté ses cendres auprès de sa sœur, sa mère à elle, il a fallu faire quelque chose avec les meubles, les choses. Et tout, dans la panique, dans l’incertitude de lendemain, a été dispersé. Et le lieu s’est perdu. C’était en 1991.
Et moi, juste à ce moment-là, je commençais ma, n’est-ce pas, très « médiatique » carrière. Sérieusement, je me lançais dans Dostoïevski, j’avais des projets pour toute ma vie (projets que je poursuis toujours), je me sentais débordant d’énergie, j’avais juste trente ans, et, d’un seul coup, par le fait d’un spectacle — le « Platonov » de Georges Lavaudant, — je me suis retrouvé avec des sous. J’ai, d’un seul coup, touché 100.000 francs — c’était, à ce moment-là, une somme considérable.
Et c’était le moment où tout bougeait en URSS, où la perestroïka entrait dans sa phase décisive — d’espoirs invraisemblables et de crises terribles. Et les frontières s’ouvraient, et il était devenu possible de « privatiser » son logement, c’est-à-dire de le racheter à l’Etat, et puis de le revendre, à des particuliers. La propriété privée surgissait au grand jour. Et un ami m’a dit que je pourrais peut-être acheter un appartement à Léningrad, pour regrouper le peu de choses qui restaient, et pour avoir un lieu où revenir. Avoir un lieu, refaire un lieu. Et j’ai acheté un grand appartement, en plein centre de ma ville, pour exactement 100.000 francs, parce que je n’avais pas plus.
*
Et le livre raconte comment, ce lieu, aujourd’hui — ce lieu physique — n’a jamais pu être le lieu mental que je cherchais. Comment le lieu physique, vivant, indépendant de vos désirs et de vos œuvres, vit de sa vie à lui, et, finalement, comment il rend le lieu mental encore plus inaccessible.
Je ne vous raconte pas tout — j’ai déjà trop publié d’extraits sur FB. Mais disons ça, — ça ne parle pas que de ce lieu-là, mais aussi de la Bretagne, parce que la Bretagne a joué un rôle de révélateur. Par la présence et le travail de Françoise, et par ses lieux à elle. Là encore, si vous voulez, vous verrez.
*
C’est un livre sur le temps, sur ces vingt ans, sur le vieillissement, et, là encore, pas que ça. C’est un livre sur ma mère. C’est un livre sur le sourire d’un bébé. C’est un livre — peut-être d’abord et avant tout sur le théâtre — qui est le « lieu » où je me suis toujours senti à ma place
*.
Et puis, sans le théâtre, il n’y aurait pas eu ce livre — du moins sous la forme dans laquelle vous le verrez. Parce que Bérangère Jannelle, qui avait monté ma traduction de « La Nuit des rois », quand je lui ai parlé de mon livre et de mon projet, et de ces deux appartements, le mental et le vrai, s’est prise de passion pour l’histoire, et elle m’a proposé de m’accompagner, avec une caméra. — Enfin, pas une caméra, justement, mais un iphone — qui répondait, en profondeur, à mon choix de publier d’abord sur FB et au fait que tout mon texte ne tenait que dans une seule phrase (oui, parce que c’est une seule phrase, du début à la fin). Elle m’a proposé de me suivre, et de filmer, tout le temps.
Nous sommes partis ensemble à Pétersbourg, au moment où je devais terminer le livre et commençais mes démarches pour revendre cet appartement. Elle m’a suivi pas à pas, avec une discrétion inouïe, une gentillesse, une attention bouleversantes. Et elle a fait des photos, en marge de son film. Ce sont certaines de ces photos que j’ai voulu reprendre — et c’est l’une d’elles qui fait la couverture. Une couverture que je trouve très belle.
Elle n’était jamais allée en Russie, elle ne parle pas russe, elle était avec moi. Un regard, une présence, une amie. De cela, le livre, dans sa matière, doit porter témoignage.
Ce sera un film étrange, je pense : suivre l’écriture d’un livre du début jusqu’à la parution… Le tournage est fini, je n’ai rien vu des rushs, évidemment, et je ne sais pas quand le montage va commencer. Je vous tiendrai au courant, inch allah. Je fais totalement confiance.
André Markowicz
Nous remercions vivement André Markowicz de nous avoir autorisés à reproduire son texte sur notre site. Vous pouvez retrouver ce texte et bien d’autres sur sa page Facebook.





